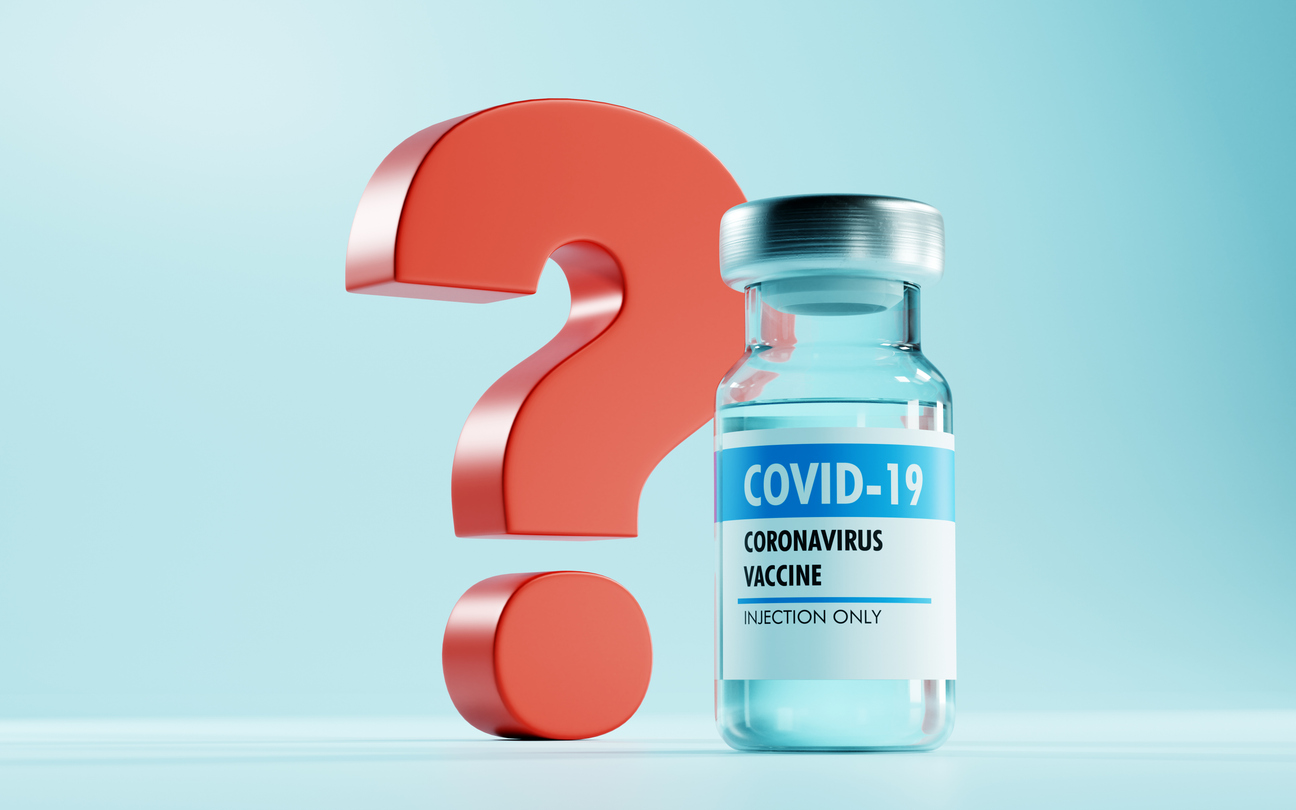Grossesse sous surveillance : infections, qui protège vraiment ?
Santé publique et médecine sociale
La grossesse est une période critique face au risque infectieux, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI). Les infections maternelles sont responsables d’une morbidité maternelle et néonatale élevée : fausses couches, prématurité, petit poids de naissance, voire décès du nourrisson. Malgré la priorité mondiale donnée à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, 95 % des décès maternels surviennent encore dans les PRFI, la majorité étant évitable avec des soins adaptés.
Les recommandations sont nombreuses, mais la réalité du terrain – accès aux soins limité, absence de dépistage systématique, faible couverture vaccinale, ressources logistiques – rend difficile la mise en œuvre de stratégies préventives complètes. Un manque de données fiables et de protocoles adaptés aux contextes locaux persiste, freinant la lutte contre ces pathologies évitables.
Dans ce contexte, il devient essentiel d’identifier et de déployer des interventions efficaces et adaptées pour prévenir et traiter les infections pendant la grossesse. La diversité des agents infectieux impliqués – bactéries, virus, parasites – nécessite une approche intégrée, combinant prévention, dépistage précoce et traitement ciblé. L’objectif de cette étude est d’identifier et d’évaluer les interventions les plus efficaces pour prévenir et traiter les infections pendant la grossesse, afin d’améliorer la santé maternelle et néonatale.
Infections maternelles : Qu’est-ce qui marche vraiment ?
Treize interventions de prévention et de prise en charge des infections durant la grossesse ont été sélectionnées afin d’identifier les stratégies les plus efficaces pour limiter les complications fœtales et néonatales, tout en évaluant l’applicabilité dans les contextes à ressources limitées.
Les interventions sont regroupées en trois grands axes :
- Vaccination anténatale (tétanos, grippe) ;
- Dépistage et prévention (moustiquaires imprégnées, prévention intermittente du paludisme, dépistage urinaire, anthelminthiques) ;
- Traitement ciblé (antibiotiques pour la syphilis, la chlamydia, les infections bactériennes, traitements des maladies parodontales).
Contrairement à la vaccination contre la grippe, la vaccination contre le tétanos a montré un impact significatif sur la mortalité néonatale, la prématurité et le faible poids de naissance dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Côté prévention et dépistage, l’utilisation de moustiquaires imprégnées permet de diminuer le risque de perte fœtale et d’améliorer le poids de naissance. Augmenter la fréquence du traitement préventif intermittent du paludisme (IPTp) réduit de façon significative les risques de faible poids de naissance et améliore le poids à la naissance. L’ajout d’un antibiotique à l’IPTp offre également un bénéfice. Par ailleurs, le dépistage et le traitement de la bactériurie asymptomatique diminuent la proportion de petits poids pour l’âge gestationnel, même si l’effet reste peu clair sur la prématurité ou la mortalité néonatale. À l’inverse, les traitements anthelminthiques ne montrent pas d’avantage démontré sur la prématurité ou la mortalité.
Enfin, concernant les traitements anti-infectieux, l’antibiothérapie ciblée contre la syphilis et la chlamydia pendant la grossesse réduit nettement les risques de prématurité, de mortinatalité et de faible poids de naissance. Le traitement des maladies parodontales semble également efficace pour limiter le faible poids de naissance, en particulier dans les contextes à ressources limitées. En revanche, le traitement de la vaginose bactérienne n’apporte pas de bénéfice majeur sur la prématurité ou la mortalité néonatale.
À lire également : ACT à la rescousse !
Cap ou pas cap d’en finir avec les infections ?
Les infections maternelles pendant la grossesse représentent une cause majeure de complications, surtout dans les pays à ressources limitées. Malgré leur impact, ces infections restent souvent sous-diagnostiquées et sous-traitées, en raison de la diversité des agents pathogènes, du manque d’accès aux soins et des difficultés logistiques à mettre en place des mesures préventives efficaces. L’objectif de cette étude était d’identifier les interventions les plus pertinentes pour prévenir et traiter ces infections, afin de réduire la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale.
Les résultats montrent que les stratégies les plus efficaces reposent sur la vaccination contre le tétanos, l’utilisation de moustiquaires imprégnées, l’augmentation du traitement préventif du paludisme et l’antibiothérapie ciblée. En revanche, d’autres interventions, comme la vaccination contre la grippe, les traitements anthelminthiques ou le traitement de la vaginose bactérienne, n’ont pas démontré d’impact significatif sur les issues néonatales dans les PRFI.
La généralisation de ces mesures reste toutefois limitée par le faible nombre d’études menées dans les pays à ressources limitées, l’hétérogénéité des protocoles et les obstacles logistiques rencontrés sur le terrain. Il est donc essentiel de renforcer la recherche, d’adapter les protocoles aux contextes locaux et de coordonner les efforts internationaux pour combler ces lacunes. Optimiser la prévention et la prise en charge des infections maternelles demeure une priorité pour réduire la mortalité maternelle et infantile et offrir aux nouveau-nés les meilleures chances de survie.
À lire également :
Source(s) :
Yasin, R., et al. (2025). Interventions to Prevent and Manage Infections in Pregnancy. Neonatology, 122(Suppl 1), 32–41 ;

Dernières revues
Grossesse sous surveillance : infections, qui protège vraiment ?

#Infection #Grossesse #Immunisation #Immunité #Vaccination  ...